Produit
- Accueil
- Minéraux
- Pierres brutes
- Stibine – Pierre brute – Taille L
Stibine – Pierre brute – Taille L
15.00 €
- Type de pierre : Stibine
- Vertus : Circulation sanguine, Confiance, Courage, Intestins, Protection
- Signe astrologique : Scorpion, Capricorne
- Chakra associés : Racine
- Couleur : Gris, Noir
- Marque : Mineraux.fr
- Dimensions : long 1 à 3cm
Description
Que vous soyez professionnel ou particulier, choisissez la pierre brute Stibine
Descriptif de la pierre brute Stibine – taille L en lithothérapie
La pierre brute stibine est mentionnée pour la première fois en l’an 77 par l’auteur latin Pline l’Ancien, mais elle est utilisée depuis le 4e millénaire avant Jésus Christ. Son appellation provient du grec “stibi” qui signifie antimoine, une autre pierre associée à la stibine. La stibine et l’antimoine sont issus du même minerai. Considérée comme la forme féminine de l’antimoine, la stibine était utilisée dans l’Egypte antique à des fins cosmétiques, notamment pour souligner le contour des yeux et maquiller les cils. Des références à cet usage sont présentes dans la bible, où Jézabel se servait de ce minéral pour se maquiller. Elle était également utilisée pour divers soins d’hygiène dans différentes civilisations telles que les Chinois, les Romains et les Grecs. Les Romains l’utilisaient comme vomitif lors de banquets, tandis que les Babyloniens l’employaient dans la fabrication de poterie. La stibine jouissait de diverses vertus dans des domaines variés selon les civilisations antiques. Au XVIe siècle, le moine Basile Valentin a décrit pour la première fois l’action de ce métal sur l’or, ce qui a marqué un tournant dans son utilisation. Principalement utilisée par les alchimistes, elle était surnommée “matière des sages” ou “loup gris des philosophes”, et on lui attribuait le pouvoir de transformer des métaux ordinaires en or. Actuellement, la stibine est employée dans le domaine de la pyrotechnie pour donner des effets scintillants aux feux d’artifice. Autrefois principalement présente au Japon, notamment dans un important gisement désormais épuisé sur l’île de Shikoku, elle est aujourd’hui extraite en Europe (Allemagne, France, Italie et Roumanie) et en Amérique du Sud (Pérou, Mexique et Bolivie). Composée de sulfure d’antimoine (SB2S3), la stibine est une espèce minérale opaque de couleur sombre, variant du noir au bleuâtre en passant par des teintes de gris foncé. Elle se présente sous la forme d’un cristal long et strié, avec un aspect irisé et métallisé. La stibine est utilisée dans l’industrie, notamment en soudure et dans l’électronique pour la fabrication de conducteurs. On la retrouve également dans le secteur textile pour ignifuger les tissus ou pour produire certains polyesters. Sa toxicité est connue depuis le XVIe siècle, et la faculté de médecine de Paris l’a interdite en 1566 en raison des nombreux effets secondaires observés chez les utilisateurs, notamment en raison de la présence de sulfure de plomb. Son utilisation doit donc être effectuée avec précaution, car elle a un impact significatif sur l’environnement en raison de sa forte pollution.
Propriétés de l’Stibine en lithothérapie
Propriétés de la pierre brute Stibine en taille L sur le plan mental en lithothérapie
- La stibine est une pierre de protection qui agit profondément sur le comportement de son porteur. Elle favorise l’épanouissement personnel et renforce la confiance en soi. Elle apporte du courage à son utilisateur, atténuant ainsi les peurs. Elle amplifie l’énergie et le pouvoir de concentration en développant des compétences de compréhension et de communication.
- La pierre stibine émane d’une énergie terrestre qui nettoie et protège, permettant ainsi le nettoyage et la libération des toxines du corps émotionnel.
Propriétés de la pierre brute Stibine en taille L sur le plan physique en lithothérapie
- Au niveau de la santé physique, la pierre stibine agit sur diverses zones du corps humain. Elle améliore la circulation sanguine, diminue les douleurs et possède un important pouvoir de diagnostic, révélant les zones susceptibles de développer des faiblesses ou des infections.
- Ses bienfaits sur le système digestif sont reconnus depuis longtemps, aidant à lutter contre la propagation de virus et de bactéries dans l’œsophage et l’estomac.
Signes astrologiques correspondant à la pierre brute Stibine
- Deux signes astrologiques sont associés à la pierre brute stibine : le scorpion, signe d’eau pour les natifs nés entre le 23 octobre et le 22 novembre, et le capricorne, signe de terre pour les natifs nés entre le 22 décembre et le 20 janvier.
- Ces deux signes zodiacaux bénéficient pleinement des pouvoirs protecteurs de la pierre stibine.
Chakra correspondant à la pierre brute Stibine
- Le chakra associé à la pierre stibine est le chakra Racine, ou Muladhara en sanskrit, situé au niveau du périnée. Il symbolise l’union entre l’esprit et la matière, favorisant la circulation de l’énergie dans le corps. Les freins à son ouverture sont la peur et l’anxiété. Une fois ouvert et équilibré, il procure confiance en soi et bien-être.
Entretien de la pierre brute Stibine en taille L
- La pierre brute stibine ne nécessite pas d’entretien spécifique. Contrairement à la plupart des pierres utilisées en lithothérapie, elle ne supporte ni l’eau ni le sel, ces éléments affaiblissant ses propriétés.
- Elle se purifie naturellement et se recharge en la laissant à l’extérieur pendant quelques heures. Les rayons du soleil et de la lune ont un effet bénéfique sur elle. Plus elle absorbe ces rayons, plus ses effets seront perceptibles lors des prochaines utilisations.
Plus d'informations
| Poids | 2 g |
|---|
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Stibine – Pierre brute – Taille L” Annuler la réponse

Stibine – Pierre brute – Taille L
15.00 €



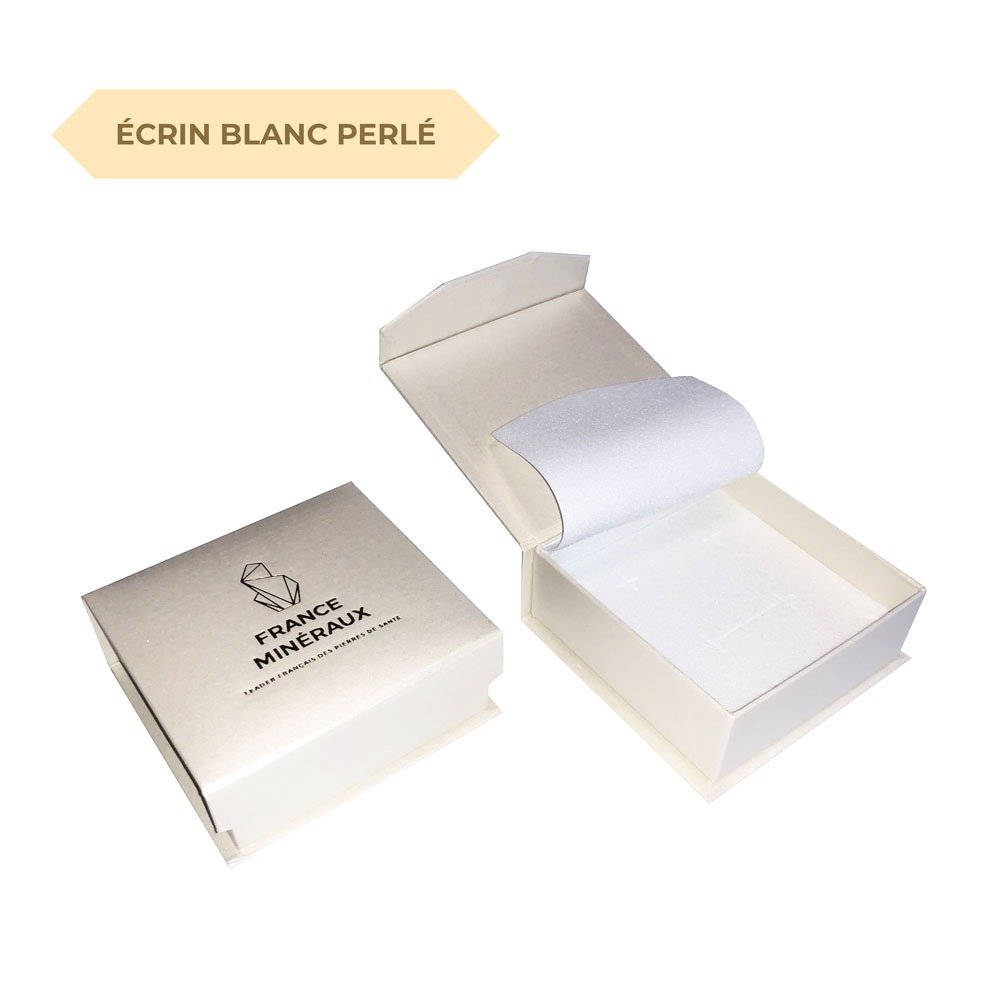













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.